Résumé :
Les immunothérapies ciblant les checkpoints immunitaires ont révolutionné la prise en charge du mélanome, d’abord au stade métastatique avancé, puis en situations adjuvante et néoadjuvante. Toutefois, vaincre l’immunorésistance primaire et secondaire reste un besoin non couvert. L’escalade thérapeutique consistant à additionner les molécules jusqu’à des triples – voire quadruples – associations se solde souvent par une toxicité majorée. Les traitements intratumoraux présentent un double avantage : celui d’agir au cœur de la tumeur, pour la rendre plus immunogène et vaincre l’immunorésistance, tout en limitant les effets indésirables systémiques. Le daromun est la première immunocytokine approuvée dans un cancer solide, en traitement adjuvant des mélanomes avec métastases cutanées et/ou ganglionnaires opérables.
- Après 20 ans de développement, la première immunocytokine intralésionnelle a été approuvée par la FDA en 2024 dans le mélanome.
- Le daromun est disponible en France en accès précoce depuis mars 2025 comme traitement néoadjuvant des mélanomes opérables de stades III à IVM1a opérables.
- Le daromun s’administre en 4 injections hebdomadaires intratumorales et permet une diminution du risque de récidive et de métastases à distance de 40 % versus chirurgie d’emblée.
- La toxicité est essentiellement locale, avec 67 % de réactions au point d’injection, généralement résolutive en 1 à 2 semaines.
- Le développement du daromun s’étend aux autres cancers cutanés hors mélanomes, qui présentent l’avantage d’être immunogènes et accessibles à un traitement intratumoral.
Malgré le progrès considérable que constituent les traitements immuno-oncologiques dans le mélanome depuis 15 ans, près de la moitié des patients au stade avancé vont progresser, malgré l’immunothérapie. Rendre ces tumeurs immunogènes est un défi thérapeutique majeur, mais augmenter la réponse sans majorer la toxicité est aussi crucial, en particulier chez les patients fragiles. L’intérêt des thérapies intratumorales (IT) serait de délivrer un produit au cœur de la tumeur, pour la détruire ou la rendre plus immunogène, tout en espérant limiter les effets secondaires [1, 2], l’idéal étant de trouver un agent IT à même de booster la réponse systémique, comme en témoignent les réponses de lésions à distance des sites injectés. Le mélanome est une tumeur particulièrement adaptée aux thérapies injectables du fait de la fréquence des atteintes cutanées et ganglionnaires, mais les carcinomes cutanés pourraient également constituer une bonne cible, car directement accessibles aux injections. Après des décennies de tentatives peu convaincantes ou toxiques (IL-2, interférons, etc.), la première immunothérapie intralésionnelle approuvée dans le mélanome est un virus oncolytique modifié, le T-VEC, qui n’est toujours pas remboursé en France [3]. Après un développement initial en phase métastatique, c’est en situation néoadjuvante que les traitements IT sont désormais déployés. L’intérêt du T-VEC en néoadjuvant avait été démontré, avec un bénéfice en termes de survie sans récidive versus chirurgie d’emblée dans un essai de phase II (NCT02211131) [4].
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances médicales

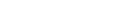 pour accéder à ce contenu.
pour accéder à ce contenu.

