Oncologie thoracique
Comme l’a écrit Julien Péron qui m’a précédé dans cette rubrique, la recherche ne s’arrête jamais. Jolie réflexion qui rappelle que plus nos connaissances augmentent, plus la surface s’agrandit entre le connu et l’inconnu. C’est de cette enveloppe fragile qui entoure le corpus de nos connaissances en cancérologie qu’émergent les nouvelles questions et naissent les nouveaux concepts.
Voici donc sélectionnées quatre publications d’intérêts divers : deux d’entre elles concernent des questions de prise en charge, et les deux autres des avancées thérapeutiques potentielles.
Ainsi, la simple avancée en âge [2], avec la baisse de l’immunosurveillance est un facteur de risque majeur. La répartition par type histologique diffère de celle observée chez les patients plus jeunes. Ainsi, chez les personnes âgées, le type épidermoïde est plus fréquent chez les fumeurs et ex-fumeurs dont la consommation était à base de tabac brun et de cigarettes sans filtre [3].
Il est probable qu’au fil des décennies, lorsque les cohortes de fumeurs âgés auront, toute leur vie, fumé des cigarettes avec filtre et du tabac blond, le sous-type adénocarcinome devienne prédominant comme c’est le cas chez les patients de moins de 70 ans depuis les années 90. Autre différence épidémiologique : les mutations somatiques de l’EGFR sont plus fréquentes chez les personnes âgées [4] ce qui vient renforcer la nécessité absolue de les rechercher à tout âge.
Il a ensuite été confirmé par les résultats de l’étude belgo-néerlandaise NELSON publiés en 2020 [2]. Depuis, plusieurs programmes de dépistage ont commencé à être instaurés dans le monde.
Le scanner jouant un rôle central dans ce dépistage, la question de son interprétation est un enjeu majeur. Plusieurs recommandations de gestion des nodules détectés ont ainsi été publiées, dont des recommandations européennes inspirées de NELSON et basées sur le calcul du temps de doublement volumique [3].
Leur but est de limiter le nombre de dépistages positifs, qui était de 24,2 % dont 96,4 % de faux positifs dans NLST [1] contre 2,1%, dont 56,5% de faux positifs dans NELSON [2]. Ce plus faible taux de dépistages positifs est lié au fait qu’une partie des nodules classés comme dépistage positif dans NLST étaient considérés comme des dépistages indéterminés dans NELSON (9,2 % des scanners), ce qui inclut notamment les nodules solides mesurant entre 50 et 500 mm3 [4].
Le dépistage nécessite également que les radiologues soient formés à la lecture et à la réalisation de ces scanners. C’est dans ce but que des programmes de certification ont été mis en place à l’échelle de l’Europe mais également en France.
L’étude RTEP7 a évalué l’efficacité et la tolérance d’une escalade de dose de radiothérapie jusqu’à 74 Gy dans un sous-volume fonctionnel défini par un TEP au fluorodésoxyglucose (18F) en cours de traitement.
Par une replanification en cours de chimio-radiothérapie portant sur un sous-volume tumoral résiduel limité, il a été possible d’augmenter en toute sécurité la dose d’irradiation : la dose médiane au volume cible est ainsi de 73,77 Gy (66,52-73,97) pour le groupe boost et de 65,94 Gy (65,79-66,02) pour le groupe standard (p < 0,0001).
L’étude a atteint son objectif principal de contrôle locorégional dans les deux bras : 77,6 % (IC95 % : 67,6-87,6) dans le groupe boost (jusqu’à 74 Gy en 33 fractions) et 71,2 % (IC95 % : 60,8-81,6) dans le groupe standard (66 Gy en 33 fractions), avec un suivi médian de 45,1 mois. La médiane de survie globale n’est pas atteinte dans le groupe boost, elle est de 43,3 mois (IC95 % : 33,4-NR) dans le groupe standard.
Contrairement aux essais précédents d’augmentation de la dose, il n’a pas été observé de majoration des toxicités aiguës ou tardives dans le bras boost, confirmant l’intérêt de la radiothérapie conformationnelle par modulation d’intensité (RCMI pour 80 % des patients) dans cette situation.
Cette stratégie thérapeutique adaptative moderne, basée sur la RCMI et couplée à une imagerie métabolique largement disponible, a permis un “coup du chapeau” : augmentation de la dose, maîtrise des toxicités et amélioration des résultats cliniques. RTEP7 est la première étude d’escalade de dose qui pose une pierre sûre en oncologie thoracique.

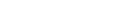 pour accéder à ce contenu.
pour accéder à ce contenu.

