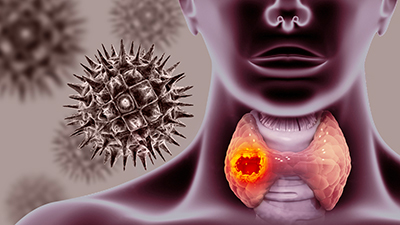Adénocarcinome pulmonaire et grossesse
Par
le Pr Jean-Louis
Pujol (CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER - MONTPELLIER)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
17 février 2025
SUNNIFORECAST : essai de phase II randomisé évaluant la combinaison nivolumab-ipilimumab versus antiangiogénique pour les cancers du rein non à cellules claires
Par
le Dr Marine
Gross-Goupil (CHU SAINT ANDRÉ - BORDEAUX)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
14 septembre 2024
Alors que la RCP CARARE est devenue une étape incontournable à l’échelle nationale dans la prise en charge des cancers du rein non à cellules claires, la question de la place de l’immunothérapie, a fortiori de la double immunothérapie nivolumab-ipilimumab interroge toujours.
Essai de phase 3 BEACON testant un anti-PD1, le tislelizumab avec une induction, la radiochimiothérapie puis en adjuvant des cancers du cavum localisés à haut risque
Par
le Dr Jérôme
Fayette (CENTRE LÉON-BÉRARD - LYON)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
6 juin 2024
Le tislelizumab avec une induction, la radiochimiothérapie puis en adjuvant dans les cancers du cavum localisés à haut risque augmente les réponses complètes au cours de l’induction. Comme indiqué dans la brève précédente, les anti-PD1 sont efficaces en adjuvant. Ici est présenté un autre anticorps, le tislelizumab.
Le bénéfice des inhibiteurs de CDK4-6 en adjuvant se précise pour les cancers du sein RH+/HER2-
Par
le Pr Florence
Dalenc (INSTITUT CLAUDIUS REGAUD- IUCT- ONCOPOLE - TOULOUSE)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
19 avril 2024
Jusque-là, nous disposions des données publiées de deux essais négatifs menés avec le palbociclib en adjuvant – étude PALLAS et PENELOPE B – et d’un essai positif en adjuvant, MonarchE, conduit avec l’abémaciclib. Ce dernier a obtenu une AMM et depuis près de 1 an, un remboursement en France, pour les patientes ayant un cancer du sein RH+/HER2-...
Hormonothérapie adjuvante dans les cancers du sein localisés à faible niveau d'expression des récepteurs aux œstrogènes (1 à 10 %)
Par
le Dr Alexandre
de Nonneville (INSTITUT PAOLI-CALMETTES - MARSEILLE)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
1 juin 2024
Les cancers du sein à faible niveau d’expression des récepteurs aux œstrogènes (1 à 10 %) sont traités comme des cancers du sein triple négatifs en France contrairement aux États-Unis où le seuil est à 1 %. Ici, nous rapportons la présentation de données issues d’une large base incluant 357 085 patients, traités ou non par hormonothérapie adjuvante pour un cancer du sein localisé ER-faible...
RTEP7 : a view to a kill, n'est plus dangereusement vôtre !
Par
le Dr Pierre
Boisselier (ICM - MONTPELLIER)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
17 février 2025
L’intensification de la radiothérapie thoracique est controversée chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules de stade III. Les précédentes tentatives d’escalade de dose ont été sanctionnées par des toxicités rédhibitoires ou ne se sont pas traduites par des bénéfices en survie.
L’étude RTEP7 a évalué l’efficacité et la tolérance d’une escalade de dose de radiothérapie jusqu’à 74 Gy dans un sous-volume fonctionnel défini par un TEP au fluorodésoxyglucose (18F) en cours de traitement.
Par une replanification en cours de chimio-radiothérapie portant sur un sous-volume tumoral résiduel limité, il a été possible d’augmenter en toute sécurité la dose d’irradiation : la dose médiane au volume cible est ainsi de 73,77 Gy (66,52-73,97) pour le groupe boost et de 65,94 Gy (65,79-66,02) pour le groupe standard (p < 0,0001).
L’étude a atteint son objectif principal de contrôle locorégional dans les deux bras : 77,6 % (IC95 % : 67,6-87,6) dans le groupe boost (jusqu’à 74 Gy en 33 fractions) et 71,2 % (IC95 % : 60,8-81,6) dans le groupe standard (66 Gy en 33 fractions), avec un suivi médian de 45,1 mois. La médiane de survie globale n’est pas atteinte dans le groupe boost, elle est de 43,3 mois (IC95 % : 33,4-NR) dans le groupe standard.
Contrairement aux essais précédents d’augmentation de la dose, il n’a pas été observé de majoration des toxicités aiguës ou tardives dans le bras boost, confirmant l’intérêt de la radiothérapie conformationnelle par modulation d’intensité (RCMI pour 80 % des patients) dans cette situation.
Cette stratégie thérapeutique adaptative moderne, basée sur la RCMI et couplée à une imagerie métabolique largement disponible, a permis un “coup du chapeau” : augmentation de la dose, maîtrise des toxicités et amélioration des résultats cliniques. RTEP7 est la première étude d’escalade de dose qui pose une pierre sûre en oncologie thoracique.
L’étude RTEP7 a évalué l’efficacité et la tolérance d’une escalade de dose de radiothérapie jusqu’à 74 Gy dans un sous-volume fonctionnel défini par un TEP au fluorodésoxyglucose (18F) en cours de traitement.
Par une replanification en cours de chimio-radiothérapie portant sur un sous-volume tumoral résiduel limité, il a été possible d’augmenter en toute sécurité la dose d’irradiation : la dose médiane au volume cible est ainsi de 73,77 Gy (66,52-73,97) pour le groupe boost et de 65,94 Gy (65,79-66,02) pour le groupe standard (p < 0,0001).
L’étude a atteint son objectif principal de contrôle locorégional dans les deux bras : 77,6 % (IC95 % : 67,6-87,6) dans le groupe boost (jusqu’à 74 Gy en 33 fractions) et 71,2 % (IC95 % : 60,8-81,6) dans le groupe standard (66 Gy en 33 fractions), avec un suivi médian de 45,1 mois. La médiane de survie globale n’est pas atteinte dans le groupe boost, elle est de 43,3 mois (IC95 % : 33,4-NR) dans le groupe standard.
Contrairement aux essais précédents d’augmentation de la dose, il n’a pas été observé de majoration des toxicités aiguës ou tardives dans le bras boost, confirmant l’intérêt de la radiothérapie conformationnelle par modulation d’intensité (RCMI pour 80 % des patients) dans cette situation.
Cette stratégie thérapeutique adaptative moderne, basée sur la RCMI et couplée à une imagerie métabolique largement disponible, a permis un “coup du chapeau” : augmentation de la dose, maîtrise des toxicités et amélioration des résultats cliniques. RTEP7 est la première étude d’escalade de dose qui pose une pierre sûre en oncologie thoracique.
Apport de l'IA pour la lecture des scanners basse dose dans le cadre du dépistage des cancers pulmonaires
Par
le Pr Guillaume
Chassagnon (HÔPITAL COCHIN - PARIS)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
17 février 2025
L'intérêt du dépistage des cancers pulmonaires par scanner basse dose a été démontré il y a 13 ans par les résultats de l’étude NLST (National Lung Screening Trial) conduite aux États-Unis [1].
Il a ensuite été confirmé par les résultats de l’étude belgo-néerlandaise NELSON publiés en 2020 [2]. Depuis, plusieurs programmes de dépistage ont commencé à être instaurés dans le monde.
Le scanner jouant un rôle central dans ce dépistage, la question de son interprétation est un enjeu majeur. Plusieurs recommandations de gestion des nodules détectés ont ainsi été publiées, dont des recommandations européennes inspirées de NELSON et basées sur le calcul du temps de doublement volumique [3].
Leur but est de limiter le nombre de dépistages positifs, qui était de 24,2 % dont 96,4 % de faux positifs dans NLST [1] contre 2,1%, dont 56,5% de faux positifs dans NELSON [2]. Ce plus faible taux de dépistages positifs est lié au fait qu’une partie des nodules classés comme dépistage positif dans NLST étaient considérés comme des dépistages indéterminés dans NELSON (9,2 % des scanners), ce qui inclut notamment les nodules solides mesurant entre 50 et 500 mm3 [4].
Le dépistage nécessite également que les radiologues soient formés à la lecture et à la réalisation de ces scanners. C’est dans ce but que des programmes de certification ont été mis en place à l’échelle de l’Europe mais également en France.
Il a ensuite été confirmé par les résultats de l’étude belgo-néerlandaise NELSON publiés en 2020 [2]. Depuis, plusieurs programmes de dépistage ont commencé à être instaurés dans le monde.
Le scanner jouant un rôle central dans ce dépistage, la question de son interprétation est un enjeu majeur. Plusieurs recommandations de gestion des nodules détectés ont ainsi été publiées, dont des recommandations européennes inspirées de NELSON et basées sur le calcul du temps de doublement volumique [3].
Leur but est de limiter le nombre de dépistages positifs, qui était de 24,2 % dont 96,4 % de faux positifs dans NLST [1] contre 2,1%, dont 56,5% de faux positifs dans NELSON [2]. Ce plus faible taux de dépistages positifs est lié au fait qu’une partie des nodules classés comme dépistage positif dans NLST étaient considérés comme des dépistages indéterminés dans NELSON (9,2 % des scanners), ce qui inclut notamment les nodules solides mesurant entre 50 et 500 mm3 [4].
Le dépistage nécessite également que les radiologues soient formés à la lecture et à la réalisation de ces scanners. C’est dans ce but que des programmes de certification ont été mis en place à l’échelle de l’Europe mais également en France.
Aidants familiaux de patients atteints de cancer : comment aider les aidants ?
Par
le Pr Jean-Louis
Pujol (CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER - MONTPELLIER)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
11 mars 2025
Le discours médical confère au médecin une position particulière, laquelle n’est pas toujours intelligible lors du colloque singulier avec le patient ou avec son proche.
Comme tout discours, il ordonne les faits dans une fonction de tri et de normalisation. Il tend naturellement à la généralisation du savoir car tout discours vise l’exhaustivité [1].
Il nous faut donc être conscients de ses limites, et de son caractère éminemment partiel; faute de quoi, la restriction du rôle de médecin à la seule énonciation d’un discours technique, réduit le malade à un simple indicateur de signes. Jean Clavreul nous rappelle qu’il n’y aurait pas de médecine s’il n’y avait pas, en amont, une demande du sujet [1].
C’est un point essentiel de satisfaire cette demande, non seulement pour le patient mais aussi pour son aidant.
Comme tout discours, il ordonne les faits dans une fonction de tri et de normalisation. Il tend naturellement à la généralisation du savoir car tout discours vise l’exhaustivité [1].
Il nous faut donc être conscients de ses limites, et de son caractère éminemment partiel; faute de quoi, la restriction du rôle de médecin à la seule énonciation d’un discours technique, réduit le malade à un simple indicateur de signes. Jean Clavreul nous rappelle qu’il n’y aurait pas de médecine s’il n’y avait pas, en amont, une demande du sujet [1].
C’est un point essentiel de satisfaire cette demande, non seulement pour le patient mais aussi pour son aidant.
Première ligne des adénocarcinomes avec mutations activatrices classiques de l'EGFR : l'association osimertinib plus chimiothérapie est-elle la meilleure solution ?
Par
le Pr Denis
Moro-Sibilot (CHU GRENOBLE - GRENOBLE)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
4 mars 2025
Les inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK) de l’EGFR représentent le traitement de référence des CBNPC avec mutations de l’EGFR. En dépit de l’enthousiasme initial, des défis thérapeutiques persistent encore en clinique.
L’osimertinib, un ITK EGFR de troisième génération, améliore la SSP par rapport aux ITK de première génération, en particulier chez les patients présentant des métastases du SNC.
L’article explore les possibilités d’associer l’osimertinib à une chimiothérapie ou à d’autres médicaments pour améliorer l’efficacité du traitement et retarder la progression cérébrale.
L’association osimertinib-chimiothérapie a donné des résultats prometteurs avec une amélioration de la SSP et de la SG mais au prix d’effets secondaires plus importants.
Cette option thérapeutique est à discuter pour les populations les plus à même d’en bénéficier.
L’osimertinib, un ITK EGFR de troisième génération, améliore la SSP par rapport aux ITK de première génération, en particulier chez les patients présentant des métastases du SNC.
L’article explore les possibilités d’associer l’osimertinib à une chimiothérapie ou à d’autres médicaments pour améliorer l’efficacité du traitement et retarder la progression cérébrale.
L’association osimertinib-chimiothérapie a donné des résultats prometteurs avec une amélioration de la SSP et de la SG mais au prix d’effets secondaires plus importants.
Cette option thérapeutique est à discuter pour les populations les plus à même d’en bénéficier.
Actualités dans la prise en charge des tumeurs thymiques : diagnostic anatomopathologique, traitements chirurgicaux et oncologiques
Par
le Dr Jennifer
Arrondeau (PARIS), le Pr Benjamin
Besse (VILLEJUIF), le Dr Audrey
Lupo (HÔPITAL COCHIN - PARIS) et M. Geoffrey
Brioude (APHM - MARSEILLE)
27 février 2025
Les tumeurs épithéliales thymiques sont des tumeurs rares, d’évolution et de pronostic variables. Leur prise en charge repose encore aujourd’hui sur un faible nombre d’études, la plupart rétrospectives. Néanmoins, il existe ces derniers temps quelques avancées diagnostiques et thérapeutiques, chirurgicales ou médicamenteuses. La dernière classification OMS décrit ainsi des nouveaux sous-types histologiques rares et en requalifie certains autres ; de même, une nouvelle classification TNM va intégrer la taille tumorale comme facteur pronostique. D’un point de vue chirurgical, les voies d’abord minimisant le caractère invasif dans la chirurgie du médiastin antérieur ont pris une place importante ces dernières années ; de plus, la chirurgie des formes localement avancées ou métastatiques a fait l’objet de quelques études nous permettant de mieux appréhender ces prises en charge. D’un point de vue oncologique, de nouveaux traitements, notamment par antiangiogéniques ou immunothérapie, devraient également permettre d’améliorer la survie de nos patients.
Évaluation, prévention et gestion des toxicités des inhibiteurs d'ALK selon que l'on souhaite débuter le traitement par un inhibiteur de 2e ou de 3e génération
Par
le Dr Bertrand
Mennecier (CHRU NANCY - NANCY), le Dr Eric
Dansin (CENTRE OSCAR LAMBRET - LILLE) et Mme Elisabeth
Gaye (BREST)
15 avril 2025
Les inhibiteurs d’ALK de 2e ou 3e génération représentent maintenant le traitement de première intention des cancers bronchiques métastatiques ALK réarrangés (ALK+). La connaissance des toxicités communes et spécifiques des molécules disponibles peut contribuer au choix du traitement initial. L’exposition généralement très prolongée des patients aux inhibiteurs d’ALK (iALK) impose aux prescripteurs un suivi bioclinique régulier et une gestion optimale des toxicités dont nous rapportons ici les principes.
Quels sont les nouveaux axes de recherche spécifiques au sujet âgé en oncologie thoracique ?
Par
le Pr Elisabeth
Quoix (CHU STRASBOURG - STRASBOURG)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
17 février 2025
L’âge médian au diagnostic d’un cancer bronchique est actuellement proche de 70 ans [1]. Ceci est lié à deux facteurs : l’augmentation de l’espérance de vie et celle de l’incidence des cancers avec l’âge. Il y a davantage de non-fumeurs chez les personnes âgées atteintes d’un cancer bronchique primitif, d’autres facteurs de risque ayant pris le pas sur le tabac (qui reste néanmoins un facteur de risque important).
Ainsi, la simple avancée en âge [2], avec la baisse de l’immunosurveillance est un facteur de risque majeur. La répartition par type histologique diffère de celle observée chez les patients plus jeunes. Ainsi, chez les personnes âgées, le type épidermoïde est plus fréquent chez les fumeurs et ex-fumeurs dont la consommation était à base de tabac brun et de cigarettes sans filtre [3].
Il est probable qu’au fil des décennies, lorsque les cohortes de fumeurs âgés auront, toute leur vie, fumé des cigarettes avec filtre et du tabac blond, le sous-type adénocarcinome devienne prédominant comme c’est le cas chez les patients de moins de 70 ans depuis les années 90. Autre différence épidémiologique : les mutations somatiques de l’EGFR sont plus fréquentes chez les personnes âgées [4] ce qui vient renforcer la nécessité absolue de les rechercher à tout âge.
Ainsi, la simple avancée en âge [2], avec la baisse de l’immunosurveillance est un facteur de risque majeur. La répartition par type histologique diffère de celle observée chez les patients plus jeunes. Ainsi, chez les personnes âgées, le type épidermoïde est plus fréquent chez les fumeurs et ex-fumeurs dont la consommation était à base de tabac brun et de cigarettes sans filtre [3].
Il est probable qu’au fil des décennies, lorsque les cohortes de fumeurs âgés auront, toute leur vie, fumé des cigarettes avec filtre et du tabac blond, le sous-type adénocarcinome devienne prédominant comme c’est le cas chez les patients de moins de 70 ans depuis les années 90. Autre différence épidémiologique : les mutations somatiques de l’EGFR sont plus fréquentes chez les personnes âgées [4] ce qui vient renforcer la nécessité absolue de les rechercher à tout âge.
Inhibiteurs des points de contrôle de l'immunité dans le cancer bronchopulmonaire : rationnel et arguments cliniques pour les associer aux anti-angiogéniques
Par
le Dr Olivier
Molinier (CENTRE HOSPITALIER - LE MANS)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
17 février 2025
Quel traitement multimodal pour les cancers du poumon non à petites cellules (CPNPC) non métastatiques opérables avec un stade IB à IIIA (8e classification TNM)
Par
le Pr Jean-Louis
Pujol (CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER - MONTPELLIER) et le Pr Laurent
Greillier (AP-HM - MARSEILLE)
17 février 2025
L'immunothérapie en première ligne dans le cancer de l'endomètre avancé
Par
le Dr Thibault
de la Motte Rouge (CENTRE EUGÈNE MARQUIS - RENNES)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
14 octobre 2024
Le dostarlimab (anti-PD1) améliore la survie globale en 1re ligne des cancers de l’endomètre avancés. La partie 1 de l’essai de phase III RUBY a évalué l’efficacité du dostarlimab en association avec le carboplatine et le paclitaxel, comparé à un placebo.

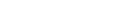 pour accéder à ce contenu.
pour accéder à ce contenu.