Pharmacologie des anticancéreux
Pharmacologie des antiangiogéniques de 2e et 3e générations : axitinib, cabozantinib, lenvatinib
Par
le Dr Marine
Gross-Goupil (CHU SAINT ANDRÉ - BORDEAUX)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
19 juin 2025
Le cancer du rein à cellules claires (CRCC) a été le premier modèle tumoral pour lequel l’arrivée des agents antiangiogéniques a littéralement révolutionné la prise en charge thérapeutique, il y a de cela presque 20 ans. L’implication des anomalies moléculaires portant sur le gène VHL, dans le processus de carcinogenèse a en effet permis le développement, dans un premier temps, d’anticorps monoclonal tel que le bévacizumab, puis des inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) de première génération, tels que les sunitinib, sorafénib et pazopanib. Désormais, le traitement de première ligne du carcinome rénal métastatique ou localement avancé repose, sauf contre-indication, sur des combinaisons soit de double immunothérapie (anti-CTLA4 et anti-PD-1) soit d’inhibiteur de point de contrôle immunitaire et d’antiangiogénique (axitinib-pembrolizumab ; cabozantinib-nivolumab ; lenvatinib-pembrolizumab). Outre le cancer du rein, ces trois ITK majeurs sont également devenus des standards de prise en charge des cancers de la thyroïde, et du carcinome hépatocellulaire pour deux d’entre eux.
Facteurs modifiant l'absorption des inhibiteurs de tyrosine kinase
Par
le Pr Antonin
Schmitt (INSERM UMR 1231 - DIJON)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
22 mai 2025
Les inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK), qui portent le suffixe -inib, sont une classe de médicaments utilisée pour traiter divers cancers. Ils agissent en inhibant la partie intracellulaire de protéines à activité tyrosine kinase, réduisant ainsi la croissance tumorale [1]. Cette classe médicamenteuse est, dans sa grande majorité, administrée par voie orale et il existe fréquemment un lien entre exposition et effets du traitement (réponse et/ou toxicité). Cette relation implique qu’une variabilité dans l’absorption des ITK, c’est-à-dire dans leur biodisponibilité, pourrait entraîner une variabilité dans leur exposition, et donc des risques de mauvaise réponse lors de sous-exposition ou de majoration des toxicités en cas de surexposition. Dans cet article, nous verrons les principales situations pouvant amener à une modification de l’absorption des ITK et qui devraient être considérées en clinique pour optimiser le traitement.
Anticancéreux disponibles chez l'adulte en accès dérogatoire en oncologie
Par
Mme Florence
Ranchon (HCL - PIERRE BENITE)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
24 avril 2025
En France, un dispositif d’accès dérogatoire aux médicaments permet aux patients en situation d’impasse thérapeutique de pouvoir bénéficier, à titre exceptionnel et temporaire, de certains médicaments innovants n’ayant pas encore d’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou de remboursement dans une indication thérapeutique donnée. Par suite de la réforme du système d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) du 1er juillet 2021, de nouveaux statuts ont été créés : l’accès compassionnel et l’accès précoce [1] :
L’accès compassionnel est demandé pour un médicament, non autorisé et non disponible en France, par un prescripteur hospitalier pour un patient nommément désigné, sous réserve que l’ANSM soit en capacité de présumer d’un rapport bénéfice/risque favorable pour une maladie grave, rare ou invalidante. Il s’agit d’une demande à réaliser en ligne via la plateforme de l’ANSM e-saturne (icsaturne.ansm.fr).
L’accès compassionnel est demandé pour un médicament, non autorisé et non disponible en France, par un prescripteur hospitalier pour un patient nommément désigné, sous réserve que l’ANSM soit en capacité de présumer d’un rapport bénéfice/risque favorable pour une maladie grave, rare ou invalidante. Il s’agit d’une demande à réaliser en ligne via la plateforme de l’ANSM e-saturne (icsaturne.ansm.fr).
Évaluation, prévention et gestion des toxicités des inhibiteurs d'ALK selon que l'on souhaite débuter le traitement par un inhibiteur de 2e ou de 3e génération
Par
le Dr Bertrand
Mennecier (CHRU NANCY - NANCY), le Dr Eric
Dansin (CENTRE OSCAR LAMBRET - LILLE) et Mme Elisabeth
Gaye (BREST)
15 avril 2025
Les inhibiteurs d’ALK de 2e ou 3e génération représentent maintenant le traitement de première intention des cancers bronchiques métastatiques ALK réarrangés (ALK+). La connaissance des toxicités communes et spécifiques des molécules disponibles peut contribuer au choix du traitement initial. L’exposition généralement très prolongée des patients aux inhibiteurs d’ALK (iALK) impose aux prescripteurs un suivi bioclinique régulier et une gestion optimale des toxicités dont nous rapportons ici les principes.
Pharmacologie des inhibiteurs de PARP (iPARP)
Par
M. Thomas
Bouyoux (CHU DIJON - DIJON) et le Pr Antonin
Schmitt (INSERM UMR 1231 - DIJON)
2 janvier 2025
Les inhibiteurs de PARP (iPARP) font partie d’une nouvelle génération de thérapies ciblées qui a majoritairement été employée initialement dans les cancers de l’ovaire, du sein, de la prostate ou du pancréas, présentant une mutation de BRCA ou apparentée (BRCAness ou Homologous Recombination Deficiency [HRD]). Néanmoins, il existe désormais de nouvelles indications, notamment dans les tumeurs ovariennes et les tumeurs du sein, où l’utilisation des iPARP est indépendante de l’existence d’un tel phénotype.
La Poly-ADP-ribose Polymérase ou PARP fait partie d’un groupe de protéines capables d’induire une réparation de l’ADN simple brin. Les iPARP entraînent donc une accumulation des cassures de l’ADN simple brin aboutissant à des cassures double brin, le tout induisant l’apoptose cellulaire. Afin de mieux comprendre leur fonction, il est nécessaire de garder en mémoire deux principes fondamentaux : la recombinaison homologue et la létalité synthétique. La recombinaison homologue est un mécanisme de réparation utilisé par les cellules saines afin de pouvoir réparer les erreurs commises dans leur ADN et donc éviter la création de cassures simple et double brin [1]. Les cellules présentant une mutation de BRCA présentent une déficience de ce système et deviennent donc sensibles aux thérapeutiques, telles que les iPARP. La létalité synthétique est définie comme le fait que la perte simultanée de deux gènes provoque la mort cellulaire, tandis que la déficience d’un seul de ces deux gènes reste compatible avec la survie de la cellule. Les cellules tumorales présentant naturellement des difficultés à réparer leur ADN du fait de mutations [2], l’hypothèse d’inhiber une seconde voie de réparation a émergé et a conduit à l’élaboration des iPARP.
La Poly-ADP-ribose Polymérase ou PARP fait partie d’un groupe de protéines capables d’induire une réparation de l’ADN simple brin. Les iPARP entraînent donc une accumulation des cassures de l’ADN simple brin aboutissant à des cassures double brin, le tout induisant l’apoptose cellulaire. Afin de mieux comprendre leur fonction, il est nécessaire de garder en mémoire deux principes fondamentaux : la recombinaison homologue et la létalité synthétique. La recombinaison homologue est un mécanisme de réparation utilisé par les cellules saines afin de pouvoir réparer les erreurs commises dans leur ADN et donc éviter la création de cassures simple et double brin [1]. Les cellules présentant une mutation de BRCA présentent une déficience de ce système et deviennent donc sensibles aux thérapeutiques, telles que les iPARP. La létalité synthétique est définie comme le fait que la perte simultanée de deux gènes provoque la mort cellulaire, tandis que la déficience d’un seul de ces deux gènes reste compatible avec la survie de la cellule. Les cellules tumorales présentant naturellement des difficultés à réparer leur ADN du fait de mutations [2], l’hypothèse d’inhiber une seconde voie de réparation a émergé et a conduit à l’élaboration des iPARP.
Anticorps conjugués utilisés en sénologie
Par
Mme Florence
Ranchon (HCL - PIERRE BENITE)
[Déclaration de liens d'intérêts]
-
21 octobre 2024
Les anticorps conjugués (ADC, Antibody Drug Conjugate) sont en plein essor en sénologie [1]. Ils permettent de cibler d’avantage l’action cytotoxique sur les cellules tumorales (l’anticorps ciblant un antigène tumoral pour agir au plus près de la tumeur), mais ne sont pour autant pas dénués d’effets indésirables, dépendants du cytotoxique ou payload, relié à l’anticorps et de la nature de l’espaceur (ou linker) utilisé. Les cytotoxiques actuellement combinés dans les ADC sont des poisons du fuseau ou des inhibiteurs puissants de topoisomérase I. La stabilité du linker permet de contrôler le relargage systémique du cytotoxique, impactant directement la tolérance potentielle de l’ADC mais également son efficacité en réduisant la diffusion du cytotoxique dans le microenvironnement tumoral, limitant ainsi l’effet by-stander. En sénologie, trois ADC sont commercialisés en 2024, dont le profil de tolérance est décrit dans le tableau I.

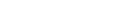 pour accéder à ce contenu.
pour accéder à ce contenu.




