Lâge médian au diagnostic d’un
cancer bronchique est actuellement proche de 70 ans [1]. Ceci
est lié à deux facteurs: l’augmentation de
l’espérance de vie et celle de l’incidence
des cancers avec l’âge. Il y a davantage
de non-fumeurs chez les personnes âgées
atteintes d’un cancer bronchique primitif, d’autres facteurs de risque ayant pris
le pas sur le tabac (qui reste néanmoins
un facteur de risque important). Ainsi,
la simple avancée en âge [2], avec la
baisse de l’immunosurveillance est un
facteur de risque majeur. La répartition
par type histologique diffère de celle
observée chez les patients plus jeunes.
Ainsi, chez les personnes âgées, le type
épidermoïde est plus fréquent chez les
fumeurs et ex-fumeurs dont la consommation était à base de tabac brun et de
cigarettes sans filtre [3]. Il est probable
qu’au fil des décennies, lorsque les
cohortes de fumeurs âgés auront, toute leur vie, fumé des cigarettes avec filtre
et du tabac blond, le sous-type adénocarcinome devienne prédominant comme
c’est le cas chez les patients de moins
de 70 ans depuis les années 90. Autre
différence épidémiologique : les mutations somatiques de l’EGFR sont plus
fréquentes chez les personnes âgées [4]
ce qui vient renforcer la nécessité absolue de les rechercher à tout âge. La nature
de la mutation d’EGFR diffère selon
l’âge : ainsi, les mutations ponctuelles
L858R sont-elles plus fréquentes que les
délétions de l’exon 19 chez les patients
âgés [5]. Les réarrangements ALK se
voient davantage chez le sujet jeune, il
n’en demeure pas moins qu’ils existent
également chez les sujets âgés. En ce qui
concerne les mutations de BRAF, leur
fréquence est au moins équivalente chez
les sujets âgés et chez les plus jeunes.
L’immunothérapie est la deuxième avancée majeure après la découverte de mutations permettant des thérapies ciblées,
en ce début de XXIe siècle, avec quelques
incertitudes en ce qui concerne son intérêt chez les personnes âgées.

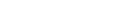 pour accéder à ce contenu.
pour accéder à ce contenu.

